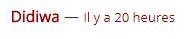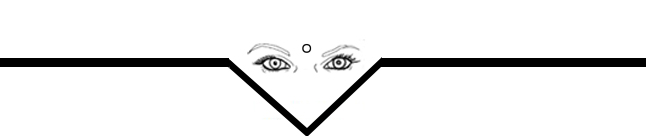Les yeux fixés sur tes pensées (cf. V. Hugo),
Tu ne sais même plus si tu es dedans ou dehors,
Ni même à quoi peut ressembler ton corps,
S’il existe bien des reflets, seule ta silhouette y est esquissée,
Il ne reste que ce regard froid et distant, dévoilant juste une âme plombée d’épuisement,
Tu as pris la route pour rejoindre Morphée,
Un chemin paisible que tu as l’habitude de suivre,
Depuis ta naissance jusqu’à ce que tu te livres,
Mais là tu n’y as croisé que des astres enflammés,
Aucun signe de vie, même pas celui de ton amie,
Elle qui t’a tant bercé, t’a laissé tomber,
Tu arpentes seul la nuit, à la recherche d’une âme qui luit,
Que te permettra de te reposer, mais en vain, elle s’est barrée.
Alors, en main le stylo, tu deviens Thoreau,
Au bord du lac Walden, tu vis tes peines,
A l’abri du vacarme, tu t’échappes du sarcasme,
Des villes sans lumières qui n’éclairent que les chemins cimetières,
Tu t’allonges dans les près, bordés de coquelicots et d’œillets,
Pour ressentir l’amour qui est en toi depuis toujours,
Pour échapper à l’aliénation qui va bon train sans concession,
Sur les bords du rivage, tu contemples les naufrages,
De ceux là qui se débattent, avant de goûter l’asphalte.
De là les temps modernes, te paraissent bien ternes,
Tu récupères les échoués, pour les remettre sur pieds,
Grace à la douceur des mots, qui atténuent leurs sanglots,
Tu n’as rien que tes verbes, pour alimenter leurs veines.
Équipé d’un sac à dos, tu traverses les monts, les ruisseaux,
Et quand tout va mal tu ris, pendant que certains prient,
Pour échapper à leurs souffrances, sans un esprit de méfiance,
Alors, quand le ciel s’embrase, il ne reste plus que tes phrases,
Pour te sortir des ténèbres, que dans tes veines coule la sève,
L’écume de tes nuits, que tes chimères prennent vie,
A l’intérieur de ton antre, que tes tripes s’échappent de ton ventre,
Avant qu’elles nécrosent, pour t’éviter une névrose.
C’est l’âme scarifiée, le visage éreinté,
Que tu quittes ce linceul, rallumant ton brûle-gueule,
Pour des siècles d’errances, nourrissant ton esprit plutôt que ta panse,
C’est en toile de fond, que s’égosillent les cons,
Qu’importe leur nombre, ils se perdent dans la pénombre.